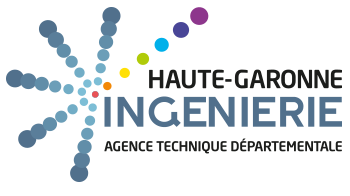Loi ALUR : Les outils fonciers (Articles 144, 146, et 147 et 163 de la loi)
Une première fiche, publiée dans ATD Actualités n°237 d’avril 2014, a présenté les principaux changements apportés au droit de préemption.
Il est proposé aujourd’hui d’aborder d’autres outils fonciers modifiés ou créés par la loi ALUR.
Les grands enjeux de la loi sur ce thème :
Afin de faciliter la densification urbaine et la construction de logements, la loi ALUR dote l’Etat et les collectivités d’outils fonciers permettant une intervention plus efficace.
LES ETABLISSEMENTS PUBLICS FONCIERS D’ETAT (EPFE) ET LES ETABLISSEMENTS PUBLICS FONCIERS LOCAUX (EPFL)
Les EPF sont des établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) à vocation foncière. Ce statut leur confère la personnalité morale et l'autonomie financière.
Opérateurs fonciers au service de l’Etat et des collectivités locales, les missions des EPF consistent principalement à :
- l’acquisition de terrains ;
- le « proto-aménagement » (remise en état des terrains : dépollution, démolitions…) ;
- la cession des biens aux porteurs de projets ;
- un rôle de conseil, d’ingénierie et d’expertise.
Pour ce faire, les EPF disposent de prérogatives de puissance publique (droit de préemption, expropriation) mais bénéficient également d’une ressource fiscale propre : la taxe spéciale d’équipement (TSE). Il s’agit d’une taxe additionnelle aux taxes locales, plafonnée à 20 euros par personne habitant dans le périmètre de compétence de l’EPF (soit en moyenne un montant de 10 € par habitant pour les EPF existants).
Les EPFE, compétents au niveau de la région ou du département, sont créés par décret en Conseil d'État, après avis des conseils régionaux, conseils départementaux, des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) compétents en matière de Programme Local de l’Habitat (PLH) et des communes de 20 000 habitants et plus non membres de ces EPCI, situés dans le périmètre de compétence.
Les EPFL sont créés par le préfet au vu des délibérations concordantes des EPCI concernés, la Région et le département pouvant participer à la création de l’EPFL et y adhérer.
A ce jour, en France, on compte 14 EPFE, dont 10 couvrant des régions entières. Il existe également 22 EPFL, créés sur des territoires départementaux ou autour d’agglomérations.
Dans le département de la Haute-Garonne existe un seul EPFL, celui du Grand Toulouse, créé en 2006.
La loi ALUR a pour objectif d’étendre la couverture du territoire national par ces EPF et, en particulier, doter la région Midi-Pyrénées d’un EPFE.
Les changements apportés :
Création de nouveaux EPFE en articulation avec des EPFL existants (article L.321-1 du code de l’urbanisme modifié)
Dans les territoires où les enjeux d’intérêt général en matière d’aménagement et de développement durables le justifient, l’Etat peut créer des EPF, pouvant se superposer totalement ou partiellement avec des EPFL créés avant le 26 juin 2013, si les collectivités concernées par cette superposition en sont d’accord.
En revanche, pour les EPFL créés après le 26 juin 2013, la loi laisse supposer que la superposition avec un EPFE ne sera pas soumise à l’accord des collectivités locales concernées. Cette différence s’explique par le fait que les dispositions seront prises pour éviter toute superposition et tout conflit potentiel, ce d'autant que le législateur a pris le soin d'harmoniser les missions des EPFL avec celles des EPFE, ajoutant en outre pour chacun :
- le développement des activités économiques,
- la protection contre les risques naturels et technologiques,
- la préservation des espaces agricoles et naturels périurbains, en coopération avec les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) et les autres organismes chargés de la préservation de ces espaces (articles L.321-1 et L.324-1 modifiés).
Modification des conditions d’adhésion à un EPFL (article L.324-2)
Le premier changement concerne les compétences d’un EPCI. Afin de favoriser l'adhésion des EPCI aux EPF locaux, qu’ils soient existants ou à créer, seule la compétence en matière de programme locaux de l'habitat (PLH) est exigée pour cette adhésion, alors qu'auparavant, l'EPCI devait être doté des compétences SCOT, ZAC et PLH.
La deuxième modification concerne l’accroissement des pouvoirs du préfet de région chargé de créer et d’étendre les EPFL. Avec la loi ALUR, il doit, au bout de trois mois après réception des délibérations des EPCI, donner son accord ou motiver son refus, sur la base de données locales relatives aux périmètres existants ou proposés d'EPF ou de SCOT et à l'évaluation des besoins fonciers correspondant aux enjeux territoriaux en matière d'urbanisme, d'habitat, de développement économique, de déplacements et d'environnement.
Elargissement des outils à la disposition des EPFL (article L.324-1)
Les EPFL disposent désormais de la possibilité de recourir au droit de préemption urbain délégué par le préfet dans les communes en constat de carence en termes de production de logements sociaux. Dans ce cas, la convention signée entre le préfet et l’EPFL affranchit ce dernier de l'obligation, préalable à toutes ses opérations, de disposer d'un avis favorable de la commune sur le territoire de laquelle l'opération est prévue.
Par délégation de ses membres, l’EPFL peut :
- exercer le droit de préemption mais aussi celui de priorité,
- agir dans le cadre des emplacements réservés,
- gérer les procédures de délaissement.
LES ASSOCIATIONS FONCIERES URBAINES DE PROJET (AFUP)
Les associations foncières urbaines (AFU) sont des associations syndicales constituées entre propriétaires intéressés pour l’exécution des travaux et opérations suivantes (articles L.322-1 et L.322-2) :
- le remembrement de parcelles et la modification corrélative de l’assiette des droits de propriété, des charges et des servitudes qui y sont attachées ainsi que la réalisation des travaux d’équipement et d’aménagement nécessaires,
- le groupement de parcelles en vue, soit d'en conférer l'usage à un tiers, notamment par bail à construction, soit d'en faire apport ou d'en faire la vente à un établissement public ou société de construction ou d'aménagement ;
- la construction, l'entretien et la gestion d'ouvrages d'intérêt collectif tels que voirie, aires de stationnement, et garages enterrés ou non, chauffage collectif, espaces verts plantés ou non, installations de jeux, de repos ou d'agrément ;
- la conservation, la restauration et la mise en valeur des secteurs sauvegardés ainsi que la restauration immobilière ;
- le remembrement foncier ou le groupement de parcelles en vue de la restructuration urbaine des grands ensembles et quartiers d'habitat dégradé.
Les AFU obéissent au régime juridique des associations syndicales de propriétaires, réformé en 2004. Mais elles sont dotées de certaines règles particulières de création ou de fonctionnement édictées par le Code de l’Urbanisme (art. L.322-1 à L.322-11 et R.322-1 à 322-40). Il existe en effet trois formes d’AFU :
- libre (créée par une démarche volontaire et contractuelle des propriétaires concernés),
- autorisée (créée sur demande faite auprès de l’autorisation administrative et après décision préfectorale)
- constituée d’office (par l’autorité administrative lorsque la création est imposée dans l’intérêt général).
Malgré leurs points positifs, tels que l’union de propriétaires se retrouvant acteurs de l’aménagement, la possibilité de rendre constructibles des parcelles qui ne l’étaient pas, l’urbanisation réalisée et financée par des intervenants privés mais sous le contrôle de la collectivité et des avantages fiscaux en matière de TVA et de plus-value, les AFU sont aujourd’hui peu usitées, notamment en raison de la complexité et de la lourdeur des procédures de création et de gestion, nécessitant un appui technique particulier, et la place prépondérante de l’Etat sur cet outil alors que le projet est communal ou intercommunal.
La loi ALUR créé donc l’Association Foncière Urbaine de Projet (AFUP) (articles L.322-12 à L.322-16 du code de l’urbanisme), un outil de projet mais aussi d’urbanisme contractuel avec la collectivité.
PRESENTATION DE L’AFUP :
Un objet précis et plus large que celui des AFU :
L’AFUP est une AFU autorisée ayant pour objet la réalisation d’un projet couplant une opération de remembrement de parcelles mitoyennes avec, comme nouveauté, une opération d’aménagement au sens de l’article L.300-1 du code de l’urbanisme, en vue de la cession à un tiers non déterminé des terrains inclus dans son périmètre.
Une création initiée par les collectivités locales :
La commune ou l’EPCI compétent en PLU, ainsi que le préfet dans le cadre d’une opération d’intérêt national, peuvent délimiter des périmètres de projet au sein desquels les propriétaires sont incités à se regrouper en AFUP. La loi ne précisant pas la forme que doit adopter cette délimitation, on peut supposer qu’il s’agisse d’une délibération.
Cette première étape est suivie d’une demande d’autorisation adressée par les propriétaires intéressés au préfet, avec copie à la commune ou l’EPCI sur le territoire duquel est prévu le projet de création. Le dossier comprend notamment un périmètre et un projet de statuts.
Cette demande fait l’objet d’une enquête publique unique sur le projet de création, le remembrement des parcelles et l’établissement éventuel de prescriptions d’urbanisme, et doit recueillir l’accord du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’EPCI (sauf projet d’intérêt national).
Des règles de fonctionnement assouplies :
Bien que calqué sur celui d’une association syndicale de propriétaires, le point sur lequel le fonctionnement de l’AFUP se distingue de l’AFU porte sur le droit de distraction des terrains. En effet, les statuts de l’AFUP peuvent prévoir que, « lorsqu'un membre de l'association souhaite vendre tout ou partie de ses terrains aménagés à un acquéreur qui ne veut pas être inclus dans le périmètre de l'AFUP et les distraire du périmètre de l'association, l'assemblée générale de l'association, à la majorité des propriétaires représentant au moins les deux tiers de la superficie des terrains de l'association ou au moins les deux tiers des propriétaires représentant plus de la moitié des superficies des terrains, peut approuver, sans enquête publique préalable, la distraction des terrains à vendre du périmètre de l'association et fixer les conditions financières dans lesquelles le vendeur reste redevable des emprunts et des participations prévues » (article L.332-16 nouveau). Ainsi, l’obstacle à la commercialisation constitué par la contrainte d’adhérer à l’association peut être écarté par un droit de distraction des terrains prévu par les statuts de l’AFUP.
Une taxation d’urbanisme qui pose question :
L'acte de création de l’AFUP pouvant être assujetti à la taxe d'aménagement et à la participation pour équipement public exceptionnel (article L.332-12 modifié), les constructeurs ne pourront être tenus d'aucune des contributions qui ont été mises à la charge du bénéficiaire de l'AFUP.Cette disposition ne va pas sans poser problème dès lors qu’il va être difficile de calculer précisément la TA au moment du projet d’AFUP.
L’ACQUISITION D’UN EMPLACEMENT RESERVE
Enfin, il convient de noter que la loi ALUR a rétabli une disposition supprimée en 2001 et qui permet à une collectivité publique autre que celle bénéficiaire d’un emplacement réservé (ER), ou au titulaire d’une concession d’aménagement, de réaliser l’acquisition du terrain concerné, la destination de l’ER restant inchangée, avec l’accord de la personne publique bénéficiaire de l’ER (article L.230-3 du code de l’urbanisme).
Les délais d’entrée en vigueur de ces mesures :
Les dispositions sont d’application immédiate, soit depuis le 27 mars 2014.
Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.