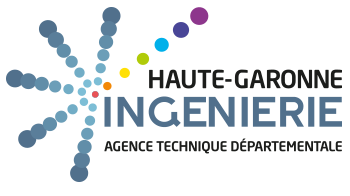La simplification du paysage intercommunal (loi n°99-586 du 12 juillet 1999 modifiée)
La simplification du paysage intercommunal s'est imposée au législateur comme une double exigence à la fois pour les collectivités locales et pour les citoyens afin qu'il y ait plus de transparence et plus de facilité à identifier le pouvoir de décision. La loi ° 99-586 du 12 juillet 1999 modifiée relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale est une nouvelle étape pour les collectivités territoriales.
Les structures de coopération existantes ne prenaient pas suffisamment en compte les problèmes liés au développement économique et à l'aménagement de l'espace et ne favorisaient guère l'émergence de groupements s'appuyant sur des territoires significatifs sur un plan économique, social et humain. Pour le citoyen, la multiplication des structures de coopération et leur enchevêtrement territorial faisaient de l'espace intercommunal un espace peu lisible et peu transparent dans la prise de décision.
La simplification du paysage intercommunal s'est donc naturellement traduite par la réduction des catégories de structures intercommunales et spécialement par la suppression des formules redondantes et peu adaptées aux exigences actuelles. Elle a été prolongée par une pluralité de mesures tendant à l'harmonisation des périmètres et des compétences des groupements afin précisément d'atteindre les objectifs de meilleure adéquation et de transparence sus évoqués. Enfin plusieurs dispositions ont été prévues pour favoriser le développement d'une intercommunalité contractuelle sans structure.
Réduction des catégories de structures intercommunales
La suppression de certaines structures est réalisée suivant des modalités spécifiques qui diffèrent selon les structures concernées.
Catégories de groupements supprimées
Deux structures doivent disparaître à court terme de l'architecture intercommunale : le district et la communauté de villes. La première disparaît en raison de son caractère redondant, la deuxième en raison de son succès limité.
Le schéma institutionnel de l'intercommunalité est désormais le suivant :
- Les syndicats de communes (à vocation unique, à vocation multiple, à la carte) et les syndicats mixtes qui représentent des structures associatives de gestion des services intercommunaux sans fiscalité propre.
- Les communautés de communes qui sont devenues des structures généralistes dotées de compétences modérément intégrées et d'une fiscalité propre.
- Les communautés d'agglomération, nouvelles structures fédératives fortement intégrées au niveau des compétences et à fiscalité spécialisée.
- Les communautés urbaines réservées aux très grandes agglomérations (500 000 habitants au moins).
- Les syndicats d'agglomération réservés aux villes nouvelles et dans lesquels l'Etat est spécialement impliqué.
Modalités de la suppression
Afin de ne pas provoquer une disparition brut ale de ces structures, le législateur a institué une procédure de transformation volontaire qui diffère selon qu'il s'agit d'un district ou d'une communauté de villes. Il convient cependant de noter que toute procédure de transformation volontaire doit être initiée par une décision de l'assemblée délibérante du groupement prise au plus tard le 1er janvier 2002. A défaut, les districts et les communautés de villes sont d'office transformés en communauté de communes. Jusqu'à leur transformation, volontaire ou autoritaire, ces structures demeurent régies par les dispositions qui leur sont propres et qui ont été refondues par le législateur (articles 53 et 57 de la loi).
Toute transformation est prononcée par arrêté du Préfet. Elle ne crée pas une nouvelle personne morale : le nouveau groupement est substitué au district ou à la communauté de villes pour l'ensemble de leurs biens, droits, et obligations.
Transformation des districts (articles 51 et 52 de la loi)
Les districts peuvent se transformer soit en communauté de communes, soit en communauté d'agglomération, soit en communauté urbaine selon une procédure simplifiée.
- La transformation en communauté de communes est possible si les 2/3 au moins des membres du conseil de district le décident. Elle n'entraîne pas de modifications dans les compétences exercées sauf si le district n'exerçait aucune des compétences pouvant être rattachées à l'un ou l'autre des groupes de compétences obligatoires ou optionnels prévus pour la communauté de communes. [La communauté de communes exerce obligatoirement des compétences se rattachant à l'aménagement de l'espace au développement économique et au minimum à l'un des groupes de compétences suivants: environnement, logement, voirie, équipements collectifs.] Dans ce cas, la loi détermine pour chaque groupe de compétences, celles qui sont attribuées d'office à la communauté de communes nouvellement créée.
Il s'agit des :
- études d'aménagement,
- études de développement économique ;
- études relatives à la lutte contre les nuisances ;
- études prospectives sur l'habitat et l'emploi ;
- définition d'un projet communautaire de développement et d'aménagement de la voirie ;
- définition d'un plan communautaire d'équipements culturels, sportifs et d'enseignement.
La transformation en communauté d'agglomération ou en communauté urbaine est ouverte aux districts qui forment un ensemble de plus de 500 000 habitants d'un seul tenant et sans enclave ou à ceux qui exercent déjà les compétences prévues pour ces deux catégories de groupements. Dans le premier cas, la transformation résulte des délibérations concordantes du conseil de district et des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population. Dans le deuxième cas, elle résulte d'une délibération du conseil de district prise à la majorité des 2/3.
Transformation des communautés de villes (articles 56 et 57 de la loi)
Les communautés de villes peuvent se transformer en communautés d'agglomération par décision du conseil de communauté prise à la majorité des 2/3 de ses membres sous réserve qu'elles exercent toutes les compétences prévues pour cette catégorie de groupement. A défaut elles peuvent se transformer en communauté de communes dans les mêmes conditions de majorité.
Harmonisation des périmètres et des compétences
La simplification du paysage intercommunal n'a pas été limitée à la réduction des catégories d'Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI). Le législateur s'est efforcé de trouver des moyens permettant d'atténuer les dysfonctionnements du dispositif existant et de lutter contre le phénomène d'empilement des structures.
Interdiction d'appartenance à deux EPCI à fiscalité propre
Désormais une commune ne peut appartenir à plusieurs EPCI à fiscalité propre (art L. 5210-2 CGCT - art 18 de la loi). Cette règle s'impose aussi bien pour éviter les superpositions de structures, que pour empêcher qu'un même contribuable soit imposé au profit de deux ou plusieurs EPCI.
Interférences de périmètres entre EPCI à fiscalité propre et syndicats de communes
Dans le cadre des superpositions, inclusions et interférences de périmètres des EPCI à fiscalité propre avec ceux des syndicats préexistants, il est prévu, lorsqu'il existe une ou plusieurs compétences communes aux groupements, une obligation de retrait des syndicats afin de faire prévaloir l'EPCI à fiscalité propre pour l'exercice de ses compétences. Cette règle va dans le sens d'une plus grande cohérence des périmètres et évite les doubles transferts de compétences. Cependant, compte tenu de la complexité actuelle d'enchevêtrement des structures syndicales, elle ne s'applique qu'aux EPCI les plus intégrés, c'est à dire les communautés d'agglomération et les communautés urbaines (art L. 5216-7 CGCT- art 1 de la loi et L. 5215-22 CGCT - art 8 de la loi), et seulement pour les compétences obligatoires exercées par ces deux groupements. Pour les compétences facultatives, le mécanisme de représentation-substitution applicable aux communautés de communes s'applique.
En cas d'interférence entre le périmètre d'un syndicat de communes et celui d'une communauté de communes, celle-ci est substituée aux communes pour l'exercice des compétences communes aux deux groupements. A cet effet le syndicat devient un syndicat mixte (art L. 5214-21 CGCT - art 24 de la loi ) auquel va adhérer la communauté de communes aux lieu et place des communes comprises dans l'interférence des périmètres.
Le législateur a cependant prévu une alternative à cette situation. Les communes peuvent être autorisées par le Préfet à se retirer du syndicat pour adhérer à la communauté de communes ou à lui retirer certaines compétences pour les transférer à la communauté de communes (art L. 5212-29-1 CGCT - art 23 de la loi).
Développement de la coopération hors structures
Dans certaines hypothèses, la création d'une structure n'est pas indispensable à la coopération entre collectivités. Aussi plusieurs mesures favorisent la coopération contractuelle:
- Un EPCI peut ainsi assurer des prestations de services pour le compte d'un autre EPCI, d'une collectivité ou d'un syndicat mixte. Il est cependant prévu de retracer les dépenses afférentes à ces prestations dans un budget annexe afin de garantir leur absence d'impact financier pour les communes membres (art L 5211-56 CGCT- art 44 de la loi).
Par ailleurs, d'un point de vue juridique, il convient que l'EPCI soit statutairement compétent pour réaliser ces prestations pour le compte de tiers et que cette activité demeure marginale par rapport à son activité principale qui est celle de mener des actions intercommunales.
- A la demande des communes et des EPCI qui le souhaitent, le département peut se voir confier par convention la responsabilité du traitement, de la mise en décharge des déchets ultimes et des opérations de transport, de tri ou de stockage qui s'y rapportent (art L.2224-13 CGCT - art 71 de la loi).
- Le conseil général et le conseil régional intéressés peuvent, à la demande de l'un ou de l'autre, être associés par un EPCI à l'élaboration de tout projet de développement et d'aménagement de son territoire en vue de fixer des objectifs généraux de partenariat ou de coopération (art L. 5210-3 CGCT - art 33 de la loi).
- Enfin l'utilisation par plusieurs collectivités d'un équipement collectif appartenant à l'une d'entre elles est officialisée par le législateur. Cette mise en commun est entourée de garanties pour la collectivité propriétaire puisque les collectivités utilisatrices sont astreintes au versement d'une participation financière aux frais de fonctionnement de l'équipement. Le montant de la participation est défini par convention. A défaut de convention au terme du délai d'un an d'utilisation la collectivité propriétaire fixe unilatéralement la participation qui devient une dépense obligatoire (art L. 1311-7 CGCT - art 72 de la loi).
Transformations
Les transformations sont désormais précisées et approfondies afin de permettre aux structures intercommunales d'évoluer plus facilement vers des formules plus intégrées.
Ainsi à l'initiative de leur assemblée délibérante, les EPCI à fiscalité propre ont la faculté de se transformer, s'ils en exercent déjà les compétences et s'ils remplissent les conditions de création, en une autre catégorie d'EPCI, par une procédure allégée distincte de la procédure de création.
La transformation est décidée par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'EPCI et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l'EPCI. La transformation est prononcée par arrêté préfectoral (art L. 5211-41 CGCT - article 41 de la loi). A l'occasion d'une procédure de transformation le périmètre de l'EPCI peut être étendu si cette extension est de nature à favoriser la cohérence spatiale économique et la solidarité financière et sociale du groupement. Des conditions de majorité qualifiée sont également prévues.
Ces procédures de transformation facilitent le changement de catégorie de groupement. Elle ne s'accompagnent pas de la création d'une nouvelle personne morale. Le second groupement prend le relais du premier ce qui évite tout effet de discontinuité dans le fonctionnement des EPCI concernés.
Les développements qui précédent retracent l'effort d'harmonisation des règles d'organisation et de fonctionnement de l'intercommunalité. Ce nouveau cadre s'est accompagné d'un renforcement de la transparence et de la démocratie intercommunale.
Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.