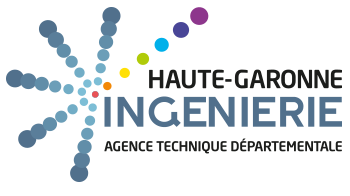Les nouvelles directives européennes relatives aux marchés publics
Deux nouvelles directives « marchés publics » (2014/24/UE et 2014/25/UE) et une nouvelle directive « concessions » (2014/23/UE) ont été adoptées par le Conseil de l’Union européenne le 11 février 2014, et publiées au Journal officiel de l’Union, le 28 mars 2014.
Leurs principaux apports sont : la simplification et la modernisation de procédures existantes ; la création d’une nouvelle procédure, le partenariat d’innovation ; la clarification de certaines notions, notamment celles de l’exception dite « in house » et de l’offre anormalement basse ; le renforcement des obligations de dématérialisation et l’encadrement des avenants.
Les États membres ont jusqu’à avril 2016 pour transposer les nouvelles règles en droit national, sauf en matière de dématérialisation, où le délai est repoussé à septembre 2018.
La présente fiche a pour objet de présenter les points essentiels de ces nouvelles directives, et de préciser le calendrier de transposition.
La simplification et la modernisation des procédures existantes
L’élargissement de la faculté de recourir à la procédure négociée et au dialogue compétitif
La faculté de recourir à la procédure négociée, désormais appelée « procédure concurrentielle avec négociation » et au dialogue compétitif,est élargie au dessus des seuils européens[1].
Les conditions permettant de recourir aux deux types de procédure sont dorénavant les mêmes. Cet alignement facilitera la possibilité de recourir au dialogue compétitif – auparavant limitée au cas de marchés complexes.
Il est notamment prévu de permettre le recours à la nouvelle procédure concurrentielle avec négociation ou au dialogue compétitif lorsque les besoins des pouvoirs adjudicateurs « ne peuvent être satisfaits sans adapter des solutions immédiatement disponibles ». A ce titre, l’utilisation de la procédure concurrentielle avec négociation devrait être possible, sous réserve de ce que précisera la jurisprudence, par exemple pour les marchés de travaux qui ne concernent pas des bâtiments standards, ainsi que pour les marchés de fournitures ou de services qui nécessitent « des efforts d’adaptation ou de conception ».
Les mesures visant à faciliter l’accès des PME à la commande publique
Des mesures de simplification au stade des candidatures, déjà transposées en droit national (voir partie finale de la présente fiche relative au calendrier de transposition), ont pour objectif de favoriser l’accès des petites et moyennes entreprises (PME) à la commande publique.
Ces mesures sont le plafonnement du chiffre d’affaires maximal exigible au titre des capacités des candidats, désormais limité au double du montant estimé du marché, et l’allègement des dossiers de candidature.
Sur ce second point, il est désormais possible d’autoriser les candidats à ne pas remettre les pièces de la candidature, sous réserve qu’ils en indiquent les modalités d’accès par le biais d’une base de données ou d’un espace de stockage numérique. De même, les candidats ont désormais le droit de ne pas fournir des documents ou renseignements déjà communiqués dans le cadre d’une précédente procédure.
Le renforcement des préoccupations sociales et environnementales
Des critères de sélection qui n’étaient pas expressément prévus par les textes précédents sont énumérés, tels que, par exemple, l’accessibilité, la conception pour tous les utilisateurs[2] et, les caractéristiques sociales, environnementales et innovantes. Le législateur européen codifie ainsi la jurisprudence et renforce dans les contrats publics les préoccupations du développement durable.
Il est à noter l’insertion d’un critère spécifique dit de « coût du cycle de vie », déjà connu en pratique sous le terme de coût d’utilisation, qui donne au critère du prix une approche plus pertinente sur le long terme.
La réduction des délais
S’agissant de l’appel d’offre ouvert, le délai de remise des offres passe de 52 jours à 35 jours, à compter de la date d’envoi de l’avis de marché.
S’agissant des appels d’offres restreints, le délai de remise des candidatures passe de 37 à 30 jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché.
Ces deux procédures pourront faire l’objet de réductions supplémentaires en cas d’urgence justifiée ou de publication préalable d’un avis de pré-information.
S’agissant de la nouvelle procédure concurrentielle avec négociation, le délai minimal de réception des demandes de participation passe de 37 à 30 jours par rapport à l’ancienne procédure négociée.
La clarification de certaines notions
La clarification des exceptions « in house »
L’exception dite « in house » exclut l’application des règles de la commande publique aux contrats passés par une personne publique lorsque cette dernière exerce sur le cocontractant un contrôle comparable à celui qu’elle exerce sur ses propres services, et lorsque l’activité de ce cocontractant est essentiellement tournée vers la personne publique.
Par exemple, les contrats de services conclus entre un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), comme une communauté de communes, et une commune membre, bénéficie de cette exception « in house ». Il en est de même des commandes adressées à une société publique locale (SPL) dont la collectivité est actionnaire, à condition que cette dernière soit en mesure d’exercer une influence décisive sur les décisions de la société.
Les nouvelles directives clarifient et assouplissent cette notion de « in house », en apportant les deux précisions suivantes :
- la possibilité d’un contrôle indirect au « 2ème degré » (l’organisme prestataire est contrôlé par un organisme lui-même contrôlé par la personne publique qui passe la commande) ;
- la possibilité de la présence de capitaux privés au sein de l’organisme prestataire, ce qui est notamment le cas de certaines sociétés d’économie mixte (SEM), à condition que cela soit imposé par une loi et que les actionnaires privés ne disposent pas de capacités de contrôle ou de blocage.
La clarification de l’offre anormalement basse
La nouvelle directive détaille les critères d’appréciation du caractère anormalement bas d’une offre.
Elle prévoit, en premier lieu, que la personne publique devra, lors de l’examen des explications fournies par le soumissionnaire sur son offre, rejeter cette dernière, s’il est établi que le caractère anormalement bas de celle-ci découle du fait qu’elle contrevient aux obligations environnementales, sociales et du travail. Il sera ainsi permis d’écarter les offres des entreprises qui tentent de tirer profit de la violation de dispositions européennes ou nationales pour diminuer anormalement leurs coûts.
Elle précise en second lieu que la personne publique pourra rejeter l’offre si les éléments de preuve fournis n’expliquent pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix proposé (il s’agit en fait d’une confirmation du régime juridique antérieur, dont la rédaction était moins précise).
La personne publique pourra donc se fonder uniquement sur le caractère inexplicable du prix ou des coûts, sans devoir en outre prouver qu’il existerait un risque pour l’exécution du marché, comme cela est le cas dans l’état du droit actuel.
La création du partenariat d’innovation
Nouvelle procédure de passation des marchés publics, le partenariat d'innovation permettra aux acheteurs publics de mettre en place un partenariat de long terme avec des entreprises couvrant à la fois la phase de recherche et de développement, d’une part et l'achat des produits, services ou travaux innovants, d’autre part, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une nouvelle mise en concurrence à chaque étape du développement de l'objet du marché.
L'objectif de ce partenariat est de simplifier la passation de marchés publics à visée innovante et aider les acheteurs publics à faire une meilleure utilisation stratégique de leurs marchés pour stimuler l'innovation.
Le recours au partenariat d’innovation ne sera toutefois possible que si le besoin du pouvoir adjudicateur, au jour où il s’exprime, ne peut pas être satisfait par le marché, du fait que les produits, services ou travaux innovants que le partenariat aura pour but de développer n’existent pas encore.
Les partenariats d’innovation pourront se nouer avec un ou plusieurs partenaires ; ces derniers pouvant mener des activités de recherche et de développement séparées.
Il est structuré en phases successives qui suivent le déroulement des étapes du processus de recherche et d’innovation. La durée et la valeur de ces phases devront notamment tenir compte du degré d’innovation de la solution proposée et du déroulement des activités de recherche et d’innovation requises pour le développement d’une solution innovante non encore disponible sur le marché (exemple d’une nouvelle application informatique utilisant une méthode technologique nouvelle, n’ayant pas encore été commercialisée).
Le renforcement des obligations de dématérialisation
Actuellement et en vertu de l’article 56 du code des marchés publics, les personnes publiques disposent d’une certaine liberté en matière de transmission des candidatures et des offres par la voie électronique, sauf dans certains cas, lorsque le montant prévisionnel du marché est supérieur à 90 000 € HT.
Au dessus de ce seuil, cette transmission électronique est en effet obligatoire pour les achats de matériels ou de services informatiques, et ne peut pas être refusée par la personne publique, pour tous les autres achats.
Les directives prévoient que la transmission électronique des candidatures et des offres sera obligatoire pour tous les achats dont le montant prévisionnel est supérieur aux seuils européens. Seules quelques exceptions seront autorisées notamment en raison des caractéristiques spécifiques du marché ou de risques pour la sécurité.
L’encadrement des avenants
Dans l’état actuel du droit national, il est permis d’augmenter par avenant le montant initial du marché sous réserve que, sauf sujétions techniques imprévues, l’objet dudit marché ne soit pas modifié et que son économie ne soit pas bouleversée (art. 20 du CMP).
Même si les décisions sont variables selon le contexte et les circonstances de l’espèce, la jurisprudence admet généralement qu’une augmentation de 10 à 20 % du montant initial ne constitue pas un bouleversement de l’économie du marché.
Les nouvelles directives prévoient que les modifications en cours d’exécution seront autorisées dans la limite de 50 % du prix par modification lorsque celles-ci auront été initialement prévues et strictement encadrées par le marché initial ou lorsqu’elles auront été rendues nécessaires pour des raisons techniques ou économiques et si le changement de cocontractant induit un inconvénient majeur ou une augmentation substantielle du prix.
Dans les autres cas, le droit aux avenants sera désormais limité à 10 % du montant initial du marché pour les fournitures et les services et 15 % pour les travaux, tous avenants confondus.
Le calendrier de transposition
Les mesures de simplification favorables aux PME et celles instituant le partenariat d’innovation ont déjà été transposées, par le décret n° 2014-1097 du 26 septembre 2014.
Pour les autres transposition, le ministère de l’Économie et des Finances vient de préciser qu’une consultation ouverte au public sur la future ordonnance de transposition devrait être lancée en mai 2015. L’ordonnance et le décret d’application devraient paraître avant la fin de l’année 2015 pour une application début 2016.
Il ne restera plus ensuite qu’à transposer les mesures relatives à la dématérialisation, avant la date limite de septembre 2018.
Parallèlement à ces opérations de transposition, le gouvernement a pour projet l’adoption à moyen terme d’un code de la commande publique à valeur législative, regroupant dans un même document l’ensemble des textes relatifs aux contrats publics, notamment les marchés, les concessions, les délégations de services publics et les contrats de partenariat (voir l’article « Bercy dévoile le tempo des réformes de la commande publique » publié le 12 mars 2014 sur la revue électronique http://www.lemoniteur.fr/).
[1] 207 000€ HT pour les fournitures et les services et 5 186 000 € HT pour les travaux, selon l’article 26 du code des marchés publics. La négociation est libre en dessous de ces seuils, selon l’article 28 du code des marchés publics, sous réserve qu’elle ait été préalablement annoncée dans les documents de la consultation.
[2] Notion qui consiste à favoriser les besoins des utilisateurs plutôt que les possibilités technologiques tout au long du processus de développement. Cette notion est notamment appliquée pour les besoins informatiques par le biais de la norme ISO 13407.
Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.