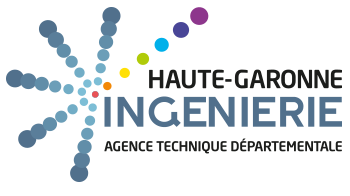Les obligations de la commune en matière d'éclairage public
Lors de la dernière assemblée du syndicat départemental d'électricité de la Haute-Garonne (SDEHG), les élus se sont interrogés sur les règles qui régissent l'éclairage public, pensant qu'une obligation générale de mise en place de tels dispositifs pèse sur la commune.
Au-delà de ces considérations réglementaires se posent également des questions pratiques liées notamment aux caractéristiques techniques des dispositifs utilisés.
Ce sont à toutes ces questions que ce Conseil en diagonale entend répondre.
Les obligations de la commune en matière d'éclairage public
Selon l'article L.2212-2 1° du code général des collectivités territoriales (CGCT), la police municipale comprend notamment « tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage (...) ».
Ces dispositions montrent que l'éclairage fait partie des mesures qu'un maire peut être amené à prendre, en sa qualité d'autorité de police municipale, afin d'assurer la sécurité et la commodité du passage sur les voies soumises à sa surveillance.
Il convient malgré tout de préciser que la mise en place d'un dispositif d'éclairage ne s'impose pas en toutes circonstances.
En effet, ainsi que l'a rappelé le juge administratif, les dépenses d'éclairage public ne figurent pas parmi les dépenses obligatoires d'une commune énumérées à l'article L.2321-2 du CGCT (CE, 13 juin 1994, « Cabrera », n° 132337). L'éclairage ne s'impose donc que s'il existe un danger avéré pour la circulation et la sécurité publiques.
Aussi, selon la situation de la voie et la configuration des lieux, l'autorité de police compétente apprécie le caractère indispensable de l'éclairage pour la sécurité des usagers de ladite voie (voir par analogie CE, 30 juillet 1997, « Parisse », n° 160935: légalité du refus d'éclairage d'un chemin rural eu égard au faible nombre d'habitation concernées), sachant que si une zone dangereuse n'est pas éclairée, et qu'un accident se produit, cette carence est considérée comme un défaut d'entretien normal de la voie et engage la responsabilité de la collectivité propriétaire (CAA Bordeaux, 14 novembre 1995, « Mme. Allier », n° 94BX01343 : à propos d'un pont permettant à un chemin départemental de franchir une rivière qui avait été submergé à la suite d'un orage et dont l'absence d'éclairage avait été à l'origine d'un accident mortel).
Il résulte donc de ce qui précède qu'il n'existe pas d'obligation générale de mise en place d'un dispositif d'éclairage, pas plus que ne pèsent sur les communes des obligations spécifiques selon les lieux (place, rue piétonne, ruelle...).
Les modalités de mise en œuvre
Deux questions reviennent régulièrement lorsque les communes s'interrogent sur la mise en place d'installations d'éclairage public:
les installations doivent-elles répondre à des normes techniques spécifiques ?
existe-t-il des contraintes en termes d'horaire ?
Les prescriptions techniques applicables
Lorsque la commune souhaite installer un éclairage public, elle doit respecter certaines règles puisque les préconisations techniques applicables aux différents types de voies varient selon les caractéristiques de celles-ci.
L'existence d'une norme européenne
La norme européenne EN 13201 « Eclairage public » à laquelle il convient encore de se référer (rappelons que cette norme est actuellement en cours de révision), « a pour objectif d'établir des prescriptions sur les zones de circulation dans les espaces publics extérieurs dans le but d'assurer la sécurité des usagers, le bon écoulement du trafic et la protection des biens et des personnes ».
Elle propose une classification des voies visant à traduire les exigences techniques applicables à chaque type de voie, en termes, par exemple, de niveaux et d'uniformité de l'éclairage. Cette classification est détaillée dans le guide d'application de cette norme, proposé par l'Association Française de l'Eclairage (revue LUX).
A noter: Ce guide peut vous être adressé sur simple demande écrite
La mise en place d'un dispositif réglementaire visant à prévenir et à limiter les nuisances lumineuses
Ce dispositif, institué par les articles L.583-1 à L.583-5 (Codification de l'article 173 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (« Grenelle 2 »)) du code de l'environnement, a pour objectif de prévenir les troubles causés par les émissions de lumière artificielle aux personnes et à l'environnement, ainsi qu'à limiter les consommations d'énergie.
Pour ce faire, il prévoit la possibilité d'imposer des prescriptions, pour réduire ces émissions « [...] aux exploitants ou utilisateurs de certaines installations lumineuses, sans compromettre les objectifs de sécurité publique [...] ».
Les installations lumineuses concernées sont définies par les articles R.583-1 et suivants du code de l'environnement, dans leur rédaction issue du décret n° 2011-831 du 12 juillet 2011 relatif à la prévention et à la limitation des nuisances lumineuses.
Il s'agit notamment de « l'éclairage extérieur destiné à favoriser la sécurité des déplacements, des personnes et des biens et le confort des usagers sur l'espace public ou privé, en particulier la voirie [...] » (article R.581-2). L'éclairage public est donc directement concerné par ce dispositif.
A noter: La publicité lumineuse et les pré-enseignes étaient également concernées par ce dispositif dans le projet de décret mais elles en ont finalement été exclues (article R.583-3 du code de l'environnement).
.
Les prescriptions techniques relatives à chacune des catégories d'installations lumineuses définies par ces articles seront fixées par arrêté du ministre de l'environnement.
Elles pourront porter sur les conditions d'implantation et de fonctionnement des points lumineux, la puissance lumineuse moyenne, les flux de lumière émis et leur répartition dans l'espace et dans le temps, ainsi que l'efficacité lumineuse des sources utilisées (article R.583-4).
Ces prescriptions pourront faire l'objet d'arrêtés préfectoraux d'adaptation (article R.583-6).
De plus, le ministre de l'environnement pourra également interdire ou limiter, à titre temporaire ou permanent, certains types de sources ou d'émissions lumineuses sur tout ou partie du territoire national si les caractéristiques locales ou la nature des sources lumineuses ou des émissions lumineuses le justifient (article R.583-5).
Enfin, le maire sera compétent pour contrôler le respect des prescriptions techniques définies par arrêté ministériel, « sauf pour les installations communales, définies selon leur puissance lumineuse totale, application, zone et équipements, pour lesquelles ce contrôle relève de la compétence de l'Etat » (article L.583-3 du code de l'environnement).
Pour finir, il convient de signaler que dans l'attente de la publication de l'arrêté ministériel fixant les prescriptions techniques applicables à chaque type d'installations lumineuses, les exigences techniques prévues par la norme EN 13201 continuent donc de s'appliquer aux installations d'éclairage existantes ou futures.
Les horaires
L'éclairage public relève du pouvoir de police du maire. Il appartient donc à ce dernier de déterminer, au vu de données objectives (telles que le trafic, la dimension ou la configuration de la voie, la dangerosité des lieux, le coût de la consommation électrique, ...), les conditions d'éclairement des voies publiques, ce qui inclut les horaires pendant lesquels les installations lumineuses fonctionnent.
En ce qui concerne les voies privées ouvertes à la circulation générale, le maire peut, eu égard aux nécessités de sécurité, ordonner aux propriétaires de ces voies de les éclairer d'une manière suffisante, aux mêmes heures et pendant la même durée que l'éclairage des rues de la commune.
Les frais de création et d'entretien des installations d'éclairage sont alors à la charge des propriétaires. Toutefois, en vertu de l'intérêt général, la commune a la faculté de contribuer à ces frais (Rép. Min. n° 6642 du 18 novembre 2002, JO AN du 7 avril 2003, p. 274).
Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.